Pour une entreprise, le moindre dysfonctionnement de son système informatique peut avoir un effet dévastateur. Par exemple, Colonial Pipeline a perdu 4 millions de dollars environ en 2021 à cause d'une cyberattaque, Marks and Spencer autour de 300 millions de livres sterling en avril 2025, Orange Roumanie a été victime d'un vol de données de 6,5 Go en février 2025, etc. Ce genre d'incident sensibilise certainement toutes les entreprises à rester plus vigilantes dans l'exercice de leur activité en renforçant encore plus leur système de sécurité. L'adoption de l'architecture Zero Trust devient alors la solution idéale. Dans cet article, vous allez en apprendre plus sur ce modèle de sécurité informatique, allant des bases essentielles à savoir sur le sujet aux avantages de son utilisation et son mode de fonctionnement.
Quels sont les principes fondamentaux de l'architecture Zero Trust ?
Tout système informatique dispose d'un système de sécurité basique qui peut être le pare-feu, l'antivirus par défaut ou installé et le contrôle du réseau. Malgré ces mesures, il reste vulnérable aux accès non autorisés. En effet, elles n'offrent pas une protection complète, à la fois interne et externe pour le système et ses utilisateurs. Pourtant, l'architecture Zero Trust agit comme un bouclier de sécurité des divers services numériques de l'entreprise, et ce, à tous les niveaux. Pour faire simple, elle signifie littéralement zéro confiance. Ce modèle de sécurité informatique implique alors qu'il faut toujours se méfier. Par conséquent, ses principes indispensables reposent sur la vérification systématique, l'accès conditionné aux ressources et la surveillance continue.
Pourquoi le Zero Trust repose-t-il sur l'authentification continue et la vérification contextuelle de chaque accès ?
Zero trust architecture se base sur l'idée qu'il ne faut jamais faire confiance par défaut. Cela signifie que tout utilisateur du réseau informatique est une menace potentielle. Au sein d'une entreprise, il exige alors l'authentification continue des utilisateurs. Ainsi, il prévient les failles de sécurité liées à la connexion au système qui peuvent se présenter sous forme de vol d'identifiant et de mot de passe. Il fonctionne également de sorte à faire une vérification contextuelle de chaque accès. Clairement, il prend en compte l'identité de l'utilisateur, comment il accède, où il se trouve et avec quel appareil il se connecte. À partir de ces données, il peut alors détecter les comportements suspects, ce qui entraîne ensuite l'application des politiques de sécurité adaptées au niveau du risque.
Comment le Zero Trust diffère-t-il des modèles de sécurité traditionnels basés sur la confiance interne ?
Les modèles de sécurité traditionnels supposent que les menaces ne proviennent que de l'extérieur. Par exemple, le castle and moat model protège seulement le périmètre du réseau. En ce sens, ils considèrent que tout utilisateur pouvant se connecter au réseau interne est digne de confiance. Pourtant, avec l'architecture zero trust, cette croyance n'existe pas tout simplement. Chaque tentative de connexion requiert une authentification continue avec l'analyse du contexte d'accès. De plus, comparé aux approches de sécurité classiques, ce modèle fonctionne très bien avec le cloud computing ou l'informatique en nuage en français.

Quels avantages l'architecture Zero Trust offre-t-elle aux entreprises ?
Parmi les solutions les plus avantageuses aux cyberattaques, l'usage de l'architecture Zero Trust serait la meilleure. Il permet de diminuer les menaces à la fois internes et externes dans un contexte de cybersécurité. De plus, son champ d'action s'adapte tout aussi bien avec le travail à distance que le cloud computing. Par ailleurs, sa fonctionnalité s'intéresse en profondeur à chaque tentative de connexion, en prenant en compte le contexte d'accès, permettant une réactivité dynamique face aux risques.
En quoi le Zero Trust permet-il de réduire les risques de violation et de limiter l'impact des attaques potentielles ?
Lorsque la sécurité d'un réseau informatique présente des failles, il s'assujettit à des menaces. Fréquemment, il s'agit de fuite de données ou de l'intrusion par un pirate informatique ou des logiciels malveillants. En ce sens, Zero Trust diminue les risques de violation en :
- Demandant l'authentification continue des utilisateurs du système informatiques, prévenant ainsi le vol d'identifiant
- Limitant l'accès aux ressources, réduisant grandement les opportunités d'attaques
- S'intéressant aux détails de connexion, permettant de réagir rapidement en cas d'accès douteux.
En outre, ce modèle de sécurité informatique réduit l'impact des attaques potentielles grâce à la surveillance continue. En effet, il permet de repérer à temps les comportements inhabituels d'un utilisateur, avant qu'il ne passe à l'action. L'architecture semble complexe, si bien que même si l'attaquant parvient à s'infiltrer, il ne pourrait pas agir librement.
Comment cette approche facilite-t-elle la transformation numérique, le télétravail et la gestion des infrastructures hybrides ?
Tout d'abord, il convient de rappeler que Zero Trust ne protège pas seulement le périmètre local en pouvant agir à tous les niveaux : les services internes et les applications cloud. De ce fait, à passer de l'analogique au monde numérique, une entreprise adopte un modèle de sécurité moderne et flexible grâce à son utilisation. De plus, avec l'essor du télétravail, cette approche offre un environnement sécurisé pour les utilisateurs, protégeant au mieux le traitement des données ainsi que les ressources disponibles. Enfin, cette architecture informatique facilite la gestion des infrastructures hybrides, car ses principes de sécurité s'appliquent partout.
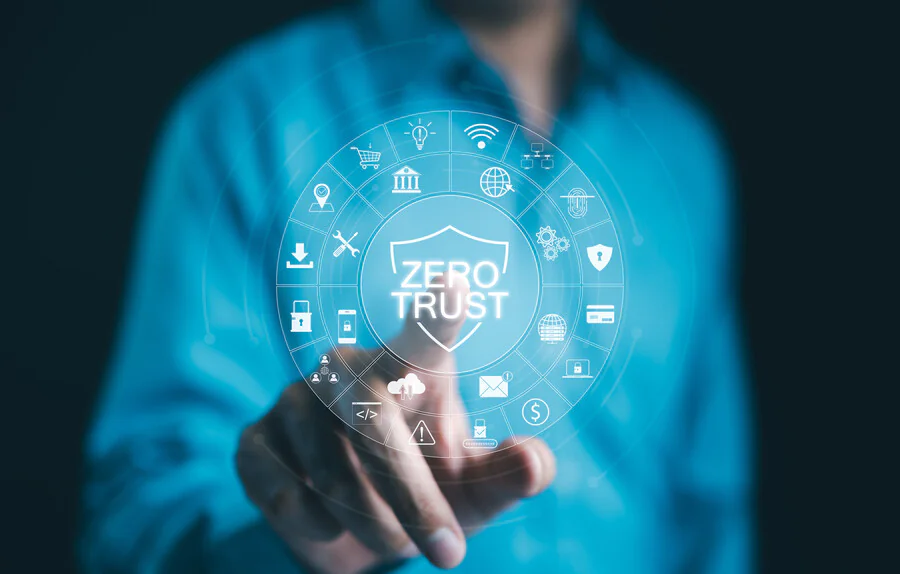
Comment mettre en œuvre une architecture Zero Trust dans une entreprise ?
Être en possession d'informations donne un certain pouvoir. Toutes entreprises devraient alors protéger ses données par tous les moyens. Pour ce faire, l'architecture Zero Trust, l'une des meilleures solutions disponibles dans le contexte, peut se mettre en œuvre par le suivi de quelques étapes seulement. Évidemment, il faudrait se munir de quelques outils aussi pour lancer une telle stratégie de sécurité. Par ailleurs, toute transition implique des obstacles à franchir pour garantir son efficacité.
Quelles étapes et quels outils sont nécessaires pour déployer une stratégie Zero Trust efficace ?
Pour déployer une stratégie de sécurité qui supprime la confiance par défaut, le Zero Trust, une entreprise devrait commencer par l'évaluation des ressources sensibles. Par exemple, il peut s'agir des appareils connectés, des utilisateurs et des données. Ensuite, il faudrait appliquer les bases de l'architecture, dont l'authentification, l'accès conditionné et le contrôle continu. Enfin, il serait judicieux de définir les politiques de sécurités relatives aux réponses automatiques. Ainsi, vous pourriez garantir une réaction dynamique face aux menaces potentielles. Pour chaque étape, divers outils sont nécessaires comme SailPoint, Okta Identity Cloud, Conditional Access Microsoft Entra, Splunk Enterprise Security, etc.
Quels sont les défis à anticiper lors de la transition vers un modèle Zero Trust (gestion des identités, visibilité, automatisation des politiques) ?
Passer d'un modèle de sécurité informatique classique au modèle Zero Trust confronte les entreprises à certains défis. D'un côté, cette approche suppose que la base de données des identités soit constamment à jour, afin de garantir la fiabilité de chaque authentification. De l'autre, son efficacité repose sur une bonne visibilité en temps réel, en tenant compte du contexte : quel utilisateur, quel appareil, depuis quel endroit, etc. Par ailleurs, Zero Trust exige l'usage d'outils aptes à réagir face aux différentes menaces potentielles, ce qui passe notamment par un bon paramétrage.
L'environnement numérique est enclin à différentes menaces. Face à cela, plusieurs solutions existent, mais l'adoption de l'architecture Zero Trust semble plus avantageuse pour les entreprises. Comparé au modèle de sécurité classique, son périmètre d'action dépasse le réseau local, en couvrant aussi les ressources cloud, par exemple. En effet, son principe de base repose sur l'idée que la confiance par défaut n'existe pas. Sa mise en œuvre reste accessible, à condition d'être rigoureux et bien équipé. Toutefois, il est important de savoir anticiper les obstacles potentiels pour garantir son bon fonctionnement.
